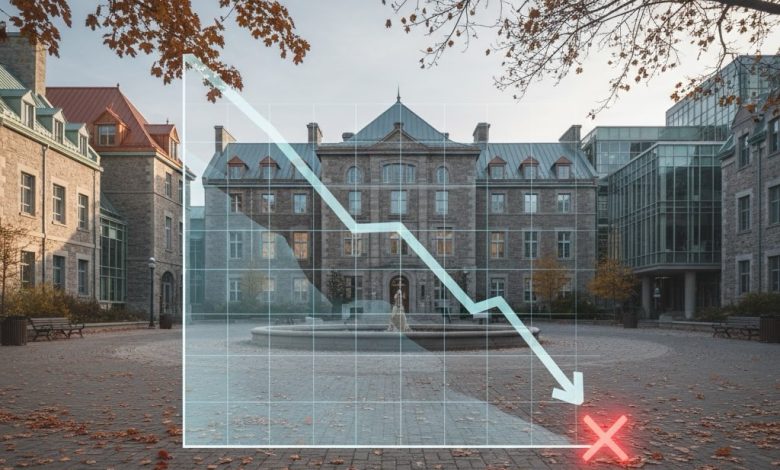
La baisse spectaculaire des inscriptions d’étudiants étrangers dans les universités québécoises suscite de vives inquiétudes dans le milieu de l’enseignement supérieur. À l’Université de Sherbrooke, la chute atteint un niveau sans précédent : près de 58 % d’inscriptions en moins au premier cycle par rapport à l’an dernier. Un recul qui illustre un malaise plus profond touchant l’ensemble du réseau universitaire de la province.
Une tendance généralisée
Selon les données récentes, plusieurs établissements québécois enregistrent des baisses importantes d’effectifs internationaux, notamment aux universités Laval, Montréal et Trois-Rivières. Ces chiffres contrastent fortement avec la situation observée ailleurs au Canada, où la présence d’étudiants étrangers continue de croître, particulièrement en Ontario et en Colombie-Britannique.
Les universités du Québec, qui ont longtemps misé sur la diversité et l’internationalisation pour renforcer leur rayonnement, se retrouvent aujourd’hui fragilisées. Le phénomène est d’autant plus préoccupant que ces étudiants représentent une source essentielle de revenus pour les institutions, en raison des frais de scolarité plus élevés qu’ils doivent acquitter.
Des causes multiples et imbriquées
Des démarches administratives décourageantes
La lourdeur des procédures d’immigration et les délais de traitement des permis d’études sont pointés du doigt par la plupart des universités. Plusieurs étudiants étrangers, notamment en provenance d’Afrique francophone, ont vu leur demande rejetée ou considérablement retardée, les empêchant d’arriver à temps pour la rentrée. Certains responsables universitaires dénoncent un manque de coordination entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, responsable de l’émission des visas et permis.
La hausse du coût de la vie et des études
À ces obstacles administratifs s’ajoute la flambée du coût de la vie. Le logement, la nourriture et les transports deviennent de plus en plus onéreux, rendant le séjour au Québec difficilement accessible pour de nombreux étudiants. Les droits de scolarité, eux aussi, ont connu une augmentation constante ces dernières années, accentuant l’écart entre les étudiants locaux et étrangers.
Une attractivité en déclin
Le Québec, longtemps perçu comme une destination accueillante pour les francophones du monde entier, semble perdre de son attrait international. Plusieurs étudiants choisissent désormais d’autres provinces canadiennes où les démarches sont plus simples et les perspectives d’emploi plus claires après les études. Le manque de visibilité des universités québécoises à l’étranger, comparativement à leurs homologues anglophones, aggrave encore la situation.
Des conséquences économiques et culturelles majeures
Un choc financier pour les universités
Les pertes financières liées à la baisse d’inscriptions se chiffrent déjà en millions de dollars pour certaines institutions. Ces revenus permettaient souvent de financer des programmes de recherche, des infrastructures et des services étudiants. Sans ces apports, plusieurs universités pourraient être contraintes de réduire leur offre de cours ou de reporter certains projets d’investissement.
Un appauvrissement de la vie universitaire
Au-delà des considérations budgétaires, c’est toute la diversité culturelle et académique des campus qui s’en trouve affectée. Les étudiants internationaux apportent des perspectives nouvelles, participent à la vitalité des échanges intellectuels et contribuent à la vie associative. « Cette baisse compromet la richesse des interactions sur nos campus », souligne un professeur de l’Université de Sherbrooke.
Un impact à long terme pour le Québec
Sur le plan économique et démographique, le recul des inscriptions étrangères pourrait freiner l’objectif du Québec d’attirer et de retenir des talents internationaux. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, chaque étudiant étranger qui choisit une autre destination représente une occasion perdue pour la province.
Des pistes de solution émergent
Accélérer les procédures d’immigration
Les universités multiplient les appels au gouvernement fédéral pour simplifier et accélérer le traitement des permis d’études. Une meilleure coordination entre Ottawa et Québec serait nécessaire pour éviter les retards et améliorer la prévisibilité des démarches.
Soutenir financièrement les étudiants
Certaines institutions envisagent la création de bourses ciblées pour des régions particulièrement touchées par les refus, comme l’Afrique francophone. Des partenariats avec des gouvernements étrangers et des organisations internationales pourraient également contribuer à rétablir la confiance.
Moderniser le recrutement international
Le recours accru au marketing numérique et à des ambassadeurs étudiants figure parmi les stratégies envisagées. Plusieurs universités souhaitent renforcer leur présence en ligne et mieux promouvoir les atouts du Québec : qualité de vie, sécurité, enseignement en français et excellence académique.
Témoignages et réalités du terrain
Des étudiants ayant tenté de s’inscrire à des universités québécoises racontent des parcours semés d’embûches : refus de visa, difficultés à trouver un logement abordable, manque d’accompagnement. Certains disent avoir renoncé à venir, préférant s’orienter vers la France ou la Belgique. D’autres, déjà installés au Québec, craignent que la baisse de la population étudiante étrangère fragilise leurs communautés et réduise les services dont ils bénéficient.
Du côté des professeurs, l’inquiétude est palpable. « Nous perdons non seulement des étudiants, mais aussi une part de notre ouverture sur le monde », confie un enseignant. « Les salles de classe deviennent plus homogènes, moins stimulantes. »
Un virage nécessaire pour préserver l’avenir
Les experts s’entendent : il faudra plus qu’un simple ajustement administratif pour inverser la tendance. Le Québec doit repenser sa stratégie d’attraction internationale, en conciliant excellence académique, accueil humain et conditions d’intégration favorables. Les universités, quant à elles, devront diversifier leurs sources de financement et renforcer leurs liens avec les milieux économiques afin d’offrir aux étudiants étrangers de véritables perspectives d’avenir.
En conclusion
La chute des inscriptions d’étudiants internationaux agit comme un signal d’alarme pour l’enseignement supérieur québécois. Elle révèle les fragilités d’un modèle trop dépendant de revenus externes et les failles d’un système administratif souvent perçu comme décourageant. À défaut d’une réaction rapide et concertée, le Québec risque de voir s’éloigner durablement une génération d’étudiants qui contribuent, depuis des décennies, à son rayonnement et à sa prospérité.